Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
Triage en trois piles
Tableau de poche
Entrevues semi-dirigées (informelles)
Discussion dirigée
Évaluation des méthodes et des outils
Les
méthodes et outils suivants ont été rodés sur le terrain pour
l'étude des groupes déterminés de pratiques d'hygiène. Chacun
d'eux peut être adapté ou modifié au besoin, en fonction des
conditions particulières. Vous pourrez aussi ajouter des
méthodes et des outils tirés de votre propre expérience ou que
vous avez utilisés au cours de votre formation, à condition
qu'ils remplissent les critères de sélection décrits au
chapitre 5 (voir diagramme 3).
Cette méthode est tirée de la démarche participative (Srinivasan, 1990) de la Promotion du rôle de la femme dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (PROWWESS). Les participants reçoivent un jeu d'illustrations représentant des situations relatives à la défécation, la protection des sources d'eau, l'utilisation de l'eau et l'hygiène personnelle, les enclos d'animaux domestiques, etc. Ils sont ensuite invités à discuter en groupe de chaque illustration et décider si elles sont bonnes, mauvaises ou ni bonnes, ni mauvaises, et pourquoi. Le triage en trois piles fonctionne selon les mêmes principes que les rôles et l'analyse des tâches, la seule différence étant que les trois piles sont «bonne, mauvaise ou ni bonne, ni mauvaise» au lieu de «homme, femme ou les deux».
Objet
• Faire tomber les barrières et instaurer une bonne communication. Pour cette raison, c'est un instrument précieux dès la prise de contact sur le terrain.
• Lancer la discussion sur des sujets sensibles/personnels comme l'emploi des latrines et la propreté personnelle, dès les premiers stades de l'étude.
Matériels
Munissez-vous d'un jeu de 12 à 16 cartes (illustrations montées sur papier cartonné) représentant les activités relatives à l'assainissement et à l'hygiène. Les dessins peuvent être réalisés par des artistes locaux ou tirés de brochures illustrées sur des questions de santé. Il est important que les cartes illustrent des pratiques et le contexte à l'échelle locale. Chaque situation décrite doit représenter au moins une activité ou une caractéristique relative à l'une des cinq catégories de pratiques d'hygiène (voir par exemple la planche 2).
Le contenu exact des illustrations dépendra des pratiques d'hygiène sur lesquelles vous avez décidé de vous concentrer, et des matériels à votre disposition. Les situations n'ayant aucun rapport avec l'hygiène mais qui sont essentielles au bon déroulement de votre projet pourront aussi être incorporées. Attribuez à chaque carte un numéro de référence pour faciliter la consignation des commentaires des gens.
Procédure
Les directives suivantes pourront être utiles à l'animateur:
• Présentez-vous et exposez l'objet de la réunion et de l'activité prévue. Exprimez-vous clairement dans la langue locale.
• Demandez aux participants si les illustrations représentent des scènes familières et si les tâches représentées sont bonnes ou mauvaises, et pourquoi.
• Si cela est nécessaire (pour permettre aux participants de parler plus librement ou pour obtenir des avis différents des différentes catégories de la population), répartissez les participants en petits groupes, par âge ou par sexe, par exemple.
• Distribuez les cartes et demandez aux participants de les faire circuler en prenant le temps de les regarder attentivement, puis discutez de chaque carte.• Écoutez et apprenez.
• Demandez au groupe de classer les cartes en trois catégories: bonne, mauvaise ou ni bonne, ni mauvaise, cette dernière catégorie s'appliquant aux illustrations trop vagues ou lorsque le groupe ne peut décider à l'unanimité si une pratique est bonne ou mauvaise.
• Prenez des notes sur les débats (y compris la décision finale, le nombre de participants) mais évitez d'intervenir.
PLANCHE 2. Illustration utilisée pour le triage en trois piles en Inde (1996)
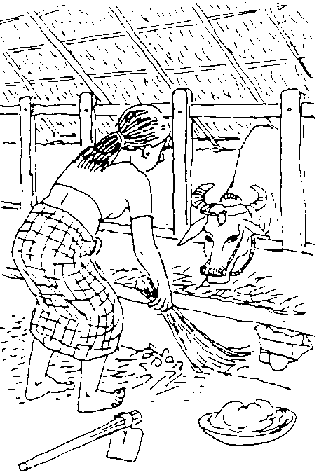
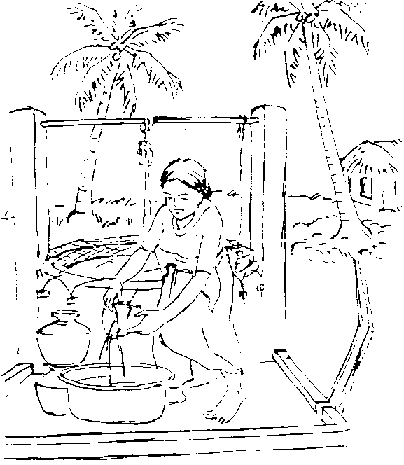
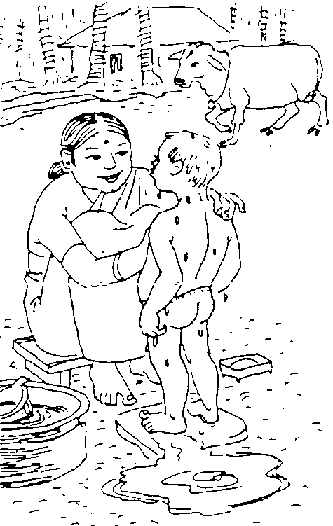
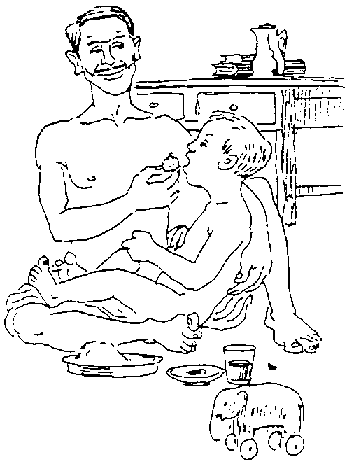
Gestion, examen et utilisation des informations
• Rédigez vos notes. Décrivez les participants/échantillons et récapitulez les commentaires de chaque groupe sur les cartes (voir encadré 19, pour un exemple de description des échantillons). Dressez une liste des principaux points et questions soulevés au cours de la discussion, les points de désaccord et les idées imprévues qui ont été suggérées.
Cette foule d'informations donnera une idée des pratiques d'hygiène qui, aux yeux des participants, sont bonnes, mauvaises ou ni bonnes, ni mauvaises, sans que cela prouve quoi que ce soit. Elle constituera un point de départ pour des investigations approfondies, faisant intervenir d'autres méthodes, telles l'observation, les entrevues, ou les discussions en groupe des principales questions.
• Dressez la liste des dessins en les classant par numéro et collationnez les commentaires du groupe sur chaque dessin.
• Relisez les commentaires de chaque groupe et faites ressortir les points de vue et les convictions identiques, ainsi que les problèmes impromptus sans rapport avec les pratiques d'hygiène. Par exemple, l'illustration sur la planche 3 (la même illustration traduite pour se rapporter à deux groupes ethniques et culturels différents) a engendré des débats animés sur la planification familiale avec une allusion particulière aux responsabilités des hommes (voir encadré 20). Définissez des questions spécifiques dans le but de réaliser des investigations plus poussées.
• Préparez des copies réduites de chaque dessin que vous incorporerez dans votre rapport d'étude accompagnés des résumés des commentaires. Ils seront ensuite placés dans une annexe du texte de votre rapport à titre de référence ou pour gagner de la place et faciliter leur lecture (voir planche 3 et encadré 20).
ENCADRÉ 19. Triage en trois piles - Exemples de descriptions d'échantillons de deux villages tanzaniens
Village 1 |
Village 2 |
||
Groupe |
Nombre |
Groupe |
Nombre |
Premier groupe de notables |
13 |
Wanaume maarufu, hommes influents |
10 |
Deuxième groupe de notables |
9 |
Wanawake maarufu, femmes
influentes |
8 |
Écoliers |
11 |
Wanawake, femmes ordinaires
(d'âge mixte) |
12 |
Écolières |
10 |
Wanafunzi wavulana, écoliers |
18 |
Jeunes hommes |
20 |
Wanafunzi wasichana, écoliers |
11 |
Vijana, jeunes hommes |
23 |
||
Cet outil est tiré de PROWWESS et peut faire l'objet de différentes applications selon le sujet de l'investigation et le type d'informations recherchées.
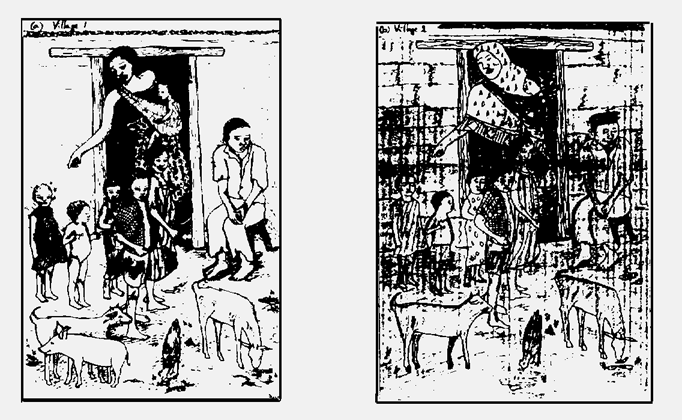
ENCADRÉ 20. Résumé des commentaires indiqués sur la planche 3 De la région de Dodoma, Tanzanie Village 1 «C'est très mauvais, c'est de la mauvaise planification familiale. L'homme a l'air perdu. Ils doivent être très pauvres, parce que l'un des enfants n'a pas de vêtements. La femme n'a pas le temps de nettoyer les abords de la maison. Elle a trop d'enfants. Les animaux sont partout, c'est mauvais.» (Premier groupe de notables du village) «C'est mauvais et fréquent dans ce village, l'homme aime trop sa femme, il y en a beaucoup comme lui qui n'arrêtent pas de faire des enfants à leurs femmes. On voir que l'un des enfants a une infection au cuir chevelu, ce qui attire les mouches autour de sa tête. Ce n'est pas bien de laisser un enfant tour nu, et les alentours ne sont pas propres.» (Deuxième groupe de notables du village) «C'est mauvais parce que les enfants sont sales. On voit que l'un des enfants a une infection au cuir chevelu, ce qui attire les mouches autour de sa tête. Tous les enfants ont l'air maigres et le père ne porte pas de chaussures. Ce genre de situations est fréquent ici.» (Groupe de jeunes hommes) Village 2 «Ce n'est ni bon, ni mauvais. L'homme ne porte pas de chaussures, les enfants non plus. C'est mauvais. Une des petites filles attire les mouches parce que son visage est sale. C'est bien que la mère le lui fasse remarquer. Les autres enfants ont le visage propre, c'est pourquoi ils ne sont pas harcelés par les mouches.» [aucune allusion à l'homme] (Groupe d'hommes influents) «C'est mauvais, parce que la femme a trop d'enfants. La femme n'a pas le temps de s'occuper d'eux.» [Cette remarque a été suivie d'un long débat sur la planification familiale.] (Groupes de femmes influentes) «C'est
mauvais, parce que les naissances ne sont pas espacées.
L'homme est mauvais, parce qu'il oblige sa femme à
concevoir des enfants les uns après les autres. Il
ferait mieux d'utiliser des "chaussettes"
[Plusieurs hommes entonnent une chanson populaire
intitulée "Vaut mieux porter des chaussettes"
composée et chantée par le Dr Rémy Ongala.] Il y a
beaucoup d'hommes comme lui au village. Si vous voulez,
on peut vous les montrer, l'environnement est sale.»
(Groupe de jeunes hommes) |
Objet
Découvrir l'usage de chaque source d'approvisionnement en eau, l'identité des utilisateurs de tel ou tel site de défécation, et pourquoi. Par exemple, dans une étude, le tableau de poche a été utilisé pour recueillir et présenter en tableaux les données sur les sources d'approvisionnement en eau en regard des différents emplois de l'eau. Dans une autre étude, il a servi à étudier le choix des sites de défécation (cour intérieure, latrine traditionnelle, latrine SANPLAT, latrine à fosse aérée, brousse) en fonction des membres d'un foyer (enfant, femme, homme, vieil homme, vieille femme) (voir figure 6).
FIGURE 6. Photos utilisées dans un tableau de poche pour étudier les utilisations de l'eau en fonction de leur source, indiquant le nombre de votes (Kenya, 1993)
Sources d'eau |
||||
Utilisations |
|
|
|
|
|
1 homme |
1 homme |
15 femmes |
1 homme |
|
3 femmes |
1 homme |
6 femmes |
|
|
2 hommes |
1 homme |
||
|
7 femmes |
5 femmes |
4 femmes |
1 femme |
|
1 homme |
3 femmes |
5 femmes |
1 femme |
|
5 femmes |
5 femmes |
6 femmes |
1 femme |
|
4 femmes |
2 hommes |
6 femmes |
1 femme |
Matériels
Un large éventail de matériels peut servir à la réalisation du tableau de poche, parmi lesquels un jeu d'illustrations correspondant à chaque variable (par ex., une source d'approvisionnement en eau ou une application de l'eau); le matériel utilisé comme support (un mur, une toile ou un autre matériau solide, ou le sol); des morceaux de papier/carte, des cailloux, des grains pour voter, indiquant les variables choisies; des pochettes ou d'autres réceptacles où seront placés les cartes (ou les grains ou les cailloux).
Procédure
• Présentez-vous et votre équipe, et exposez l'objet de la réunion en vous exprimant clairement dans la langue locale.
• Présentez le tableau de poche en le montrant aux participants et en décrivant le matériau dont il est fait.
• Demandez aux participants de faire circuler les illustrations et d'en discuter le contenu. Écoutez et apprenez.
• Parvenez à un consensus avec les participants sur le contenu de chaque illustration. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans l'esprit des participants quant à la signification de chaque illustration. Discutez et éclaircissez les points qui ne seraient pas clairs.
• Demandez aux participants s'ils souhaitent rajouter des variables qui n'auraient pas été prises en compte. Si la réponse est oui, trouvez une illustration ou un symbole représentant la ou les nouvelles variables (si l'équipe comprend un artiste, demandez à celui-ci de réaliser les illustrations sur-le-champ puis faites-les circuler pour obtenir l'approbation des participants).
• Commencez par des pochettes vierges et expliquez le déroulement et les règles du vote.
• Faites une démonstration - une simulation de vote à découvert.
• Distribuez des bulletins de vote - attribuez une couleur différente selon le sexe ou l'âge, le cas échéant.
• Recouvrez les pochettes, et retournez le tableau de poche pour que les gens puissent voter en secret, et commencez le scrutin en utilisant une variable à la fois.
• Donnez les résultats aux participants avant de passer à la variable suivante.
• Notez le nombre de bulletins de vote dans chaque pochette.
• Analysez et discutez des résultats avec les participants.
Gestion, examen et utilisation des informations
• Consignez au propre les notes sur les discussions qui ont eu lieu lors de l'utilisation du tableau de poche.
• Présentez les résultats du vote sous forme de tableaux et préparez un graphique représentant leurs illustrations ou leur description en texte et en nombre de votes tel qu'il est illustré à la figure 6 (voir encadré 21 «Extraits des notes d'une discussion sur le tableau de poche»).
Les entrevues semi-dirigées sont une méthode anthropologique standardisée qui est très largement employée dans les investigations sanitaires.
Objet
• Enquêter sur des problèmes spécifiques et généraux en posant des questions de façon informelle, mais systématique.
• Découvrir pourquoi certaines pratiques d'hygiène sont jugées idéales ou acceptables, et pourquoi.
ENCADRÉ 21. Extraits des notes d'une discussion sur le tableau de poche D'un village de l'Ouest du Kenya Lorsque l'équipe chargée de l'étude a annoncé les résultats du vote, les participants ont analysé les résultats et en ont discuté. Sur un total de vingt participants (17 femmes, trois hommes), la majorité, soit 15 femmes, ont indiqué qu'elles allaient chercher de l'eau destinée à la consommation à la pompe manuelle. Elles ont expliqué qu'elles pensaient que l'eau était propre et que la source était pratique, puisque la plupart d'entre elles habitaient à proximité du trou de forage. Pour ce qui est de l'eau destinée à d'autres usages, la pompe manuelle faisait beaucoup moins d'adeptes. Il apparaît donc clairement que ces femmes choisissaient leurs sources d'approvisionnement en eau en se fiant à leur bon sens. La
séance de révision a permis aux participants de
confirmer ou de remettre en cause les votes: un jeune
homme a formulé des doutes sur la fiabilité du nombre
de votes relatifs à l'utilisation de la pompe manuelle
pour l'eau d'arrosage des potagers. Selon lui, les six
femmes ne disent pas la vérité. «Comment ces femmes
peuvent-elles avoir assez d'eau pour arroser leur
jardin?» a-t-il demandé. D'autres se sont rangés
derrière lui, sachant bien que chaque foyer n'avait
droit qu'à deux seaux d'eau par jour à la pompe
manuelle. Les femmes ont débattu de la question avant
que l'une d'elles n'explique qu'en dehors de leur propre
consommation, elles utilisaient l'eau pour d'autres
tâches, comme par exemple, le lavage des ustensiles,
avant de «la jeter dans le jardin.» Il s'agissait donc
simplement d'un cas de recyclage de l'eau, et un exemple
de gestion rationnelle d'une ressource peu abondante. |
Outil
L'intervieweur doit étudier un plan d'entrevues préparé à l'avance, comportant la formation spécifique de l'équipe chargée de l'étude pour lui permettre de se familiariser ou de perfectionner ses techniques d'entrevue, des discussions sur l'énoncé des questions, d'éventuelles modifications à ces énoncés, la traduction des questions choisies dans la ou les langues locales, et la re-traduction en anglais ou en français pour vérifier que le sens du message est correctement véhiculé. Le plan d'une entrevue semi-dirigée (voir la fiche de travail 2) est souvent utilisé avant, plutôt que pendant les entrevues proprement dites.
Procédure
• Étudiez votre plan d'entrevues semi-dirigées à l'avance pour avoir le temps de vous familiariser avec le champ et l'énoncé des questions choisies. Vous pouvez noter succinctement les énoncés des questions et les sujets abordés à titre d'aide-mémoire. Répétez l'énoncé des questions en présence des membres de votre équipe et sollicitez de leur part des critiques constructives (voir chapitre 3).
• Si possible, demandez à un membre de l'équipe de vous accompagner au domicile de la ou des personnes à interviewer et de prendre des notes pendant l'entrevue.
• Commencez par vous présenter, la personne qui vous accompagne, ainsi que les autres membres de l'équipe qui sont présents (par ex., l'observateur); instaurez une relation amicale avec la personne interrogée et sa famille (voir introduction du chapitre 3).
• Écoutez attentivement et faites preuve de bon sens, même si vous connaissez par coeur le plan de l'entrevue. Par exemple, ne demandez pas à votre interlocuteur si ses enfants sont en âge d'utiliser la latrine, s'il vous a déjà dit ne pas avoir d'enfants.
• Évitez de poser des questions tendancieuses.
• Maniez les questions incitatives et les questions exploratoires avec doigté.
• Mettez fin à l'entrevue en remerciant votre interlocuteur et les personnes qui vous ont apporté leur concours.
Fiche de travail 2
Exemple de guide d'entrevue semi-dirigée
Nom:
Village/localité/ville/camp/zone/quartier:
1. Salutations (par exemple, «Bonjour; comment-allez-vous et comment vont vos enfants? D'autres membres de la famille?» etc.)
* 2. Combien d'enfants avez-vous?
Filles:------------
Garçons:--------
Nom
Âge
Nom
Âge
* Dans bon nombre de populations ethniques, c'est une question délicate bien que nous n'ayons eu aucun problème pour la poser après la question précédente (exprimant un intérêt pour le bien-être des enfants). Vous pouvez la remplacer par la question suivante: «Parlez-moi de vos enfants».
3. Les enfants sont-ils capables de se servir tout seuls de la latrine?
4. Si non, où vont-ils à la selle?
5. Par quel moyen évacuez-vous les excréments?
6. Qui d'autre utilise la latrine?
7. Utilisez-vous la latrine?
8. Si non, pourquoi?
9. Pensez-vous que les excréments des enfants sont nocifs?
10. Pourquoi?
11. Les enfants ont-ils souffert de diarrhée ces deux ou trois derniers jours?
12. Quelle en était la cause?
13. Comment avez-vous traité ce problème?
14. Qui d'autre a eu la diarrhée au cours deux ou trois derniers jours?
15. Comment a-t-elle été traitée?
16. Où vous approvisionnez-vous en eau?
17. En quelle quantité? Et avec quelle fréquence?
18. Qu'en faites-vous?
19. Traitez-vous l'eau avant de la consommer ou de la destiner à d'autres usages:
(a) en la filtrant
(b) en la laissant reposer
(c) en y versant des cendres et en la laissant reposer
(d) en la taisant bouillir
(e) par d'autres moyens
20. L'eau est-elle payante? Combien?
21. Quand vous lavez-vous les mains avec du savon/des cendres/d'autres produits de nettoyage locaux?
22. Pourquoi? Et si non, pourquoi?
Gestion, examen et utilisation des informations
À la fin de chaque entrevue, essayez de trouver le temps de rédiger au propre les notes prises pendant l'entrevue. Il y a des chances qu'elles soient très courtes, c'est pourquoi vous devez les développer et les annoter en compagnie des autres membres de l'équipe. Vous pouvez, par exemple, développer les points que vous n'avez pas eu le temps de noter et qui vous reviennent à l'esprit, et vous pouvez les annoter avec vos propres idées - questions pertinentes, intérêt des observations, thèmes, etc. Il peut être utile de prévoir des marges assez larges ou d'écrire sur une seule page, en réservant la page en face pour vos commentaires et d'éventuels détails supplémentaires.
Les
informations obtenues dans le cadre des entrevues sont
généralement analysées par des systèmes de catégorisation,
d'indexage et de classement pour faciliter leur gestion et leur
analyse. Par exemple, vous pouvez organiser un fichier ou un
index particulier pour chaque catégorie ou sous-catégorie de
pratiques d'hygiène, ou bien pour chaque catégorie
d'informations relatives au contexte local. Il existe désormais
des programmes logiciels spéciaux que l'on peut utiliser pour
l'analyse de données textuelles, mais un simple traitement de
texte informatique suffira pour faciliter le classement et
l'indexation des informations qualitatives. L'encadré 22
explique comment consigner des données provenant d'entrevues ou
d'observations avant qu'elles ne soient examinées par l'équipe
chargée de l'étude.