Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
Cette méthode est une adaptation du schéma chronologique de l'ERP qui est utilisée pour recueillir des informations chronologiques. Cette méthode est excellente pour établir de bonnes relations entre l'équipe chargée de l'étude et les participants, car elle crée un climat de confiance chez la population locale, en particulier parmi les anciens. Les investigateurs ont souvent tendance à solliciter les chefs de la communauté, négligeant les anciens, alors que ceux-ci sont parfois des sources plus fiables concernant l'histoire de leur localité. L'historique repose sur l'intervention de ces gens (y compris les informateurs clés) dans le cadre des discussions en groupe et des analyses de l'histoire locale, ce qui est un moyen de mettre en valeur leurs connaissances.
Objet
• Étudier l'histoire locale au sens large (par ex., en se renseignant sur les événements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont une signification particulière pour la population locale).
• Étudier des questions particulières sur la gestion des richesses naturelles (eau, terres et combustibles).
Matériels
Utilisez des objets que vous trouverez sur place, par exemple, un bâton pour tracer des lignes sur le sol, et des cailloux ou des feuilles pour indiquer les événements et les noms des chefs sur le schéma historique. Les dates et les noms qui représentent des événements marquants sont indiqués sur le schéma historique.
Procédure
• Invitez les anciens de la localité à rencontrer au moins deux membres de l'équipe chargée de l'étude pour une consultation sur l'historique de la région.
• Expliquez aux anciens que vous êtes intéressé par les événements importants qui ont jalonné leur histoire, qu'il en reste ou non des traces écrites. Assurez-leur que votre but est d'apprendre et non de juger, et que vous n'avez aucunement l'intention d'utiliser les informations qu'ils vous donneront à leur détriment.
• Écoutez et apprenez.
• Encouragez chaque participant à intervenir dans la discussion. Si un point n'est pas clair, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Si vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris, ou si vous avez l'impression que des informations sont contradictoires ou surprenantes, demandez confirmation.
• Une fois le tableau de l'historique et la discussion terminés, récapitulez oralement et demandez aux participants si votre résumé correspond exactement à ce qui a été dit, puis notez leurs réponses. Remerciez les participants de leur concours et mettez fin à la réunion. Vous pouvez servir des rafraîchissements, le cas échéant.
• À un autre moment, présentez le tableau de l'historique devant un groupe plus important de participants à l'étude. Vous pouvez par exemple débuter votre prochaine discussion en groupe par un compte rendu de ce que vous avez appris sur l'histoire locale à l'aide du schéma historique. Ainsi, vous aurez plus de chances de susciter l'intérêt des participants.
Gestion, examen et utilisation des informations
L'historique doit être transcrit sur papier afin d'être discuté par l'équipe chargée de l'étude. Pour cela, vous pourrez dessiner votre schéma sur un tableau-papier en y faisant apparaître les dates et les noms importants et des légendes au besoin. La transcription détaillée du compte rendu de la réunion pourra être effectuée séparément. La figure 3 et l'encadré 14 présentent un exemple d'historique pour la région de Dodoma, dans le district de Kondoa en Tanzanie. Dans cet exemple, l'historique a été utilisé pour essayer de comprendre pourquoi les premiers colons ont choisi de s'installer dans le village de Kwayondu, en dépit de ses pénuries d'eau chroniques. La réponse a été apportée dès le début de la réunion. Six anciens du village ont pris part à l'élaboration de l'historique, lequel a ensuite été présenté et vérifié au cours d'une réunion plus importante.
Le schéma de l'historique peut servir d'outil de référence et de surveillance dans le cadre des activités de suivi. Il est possible, par exemple, que les groupes communautaires locaux souhaitent en conserver un exemplaire comme pièce n'ayant pas encore été documentée. L'exemple présenté à la figure 3 pourra servir de repère pour suivre les progrès du projet d'approvisionnement en eau financé par Water-Aid et être mis à jour à intervalles réguliers.
ENCADRÉ 14. Extraits de notes prises au cours de la discussion sur un historique Du village de Kwayondu, en Tanzanie D'après les wazee, les anciens du village, le village de Kwayondu s'appelait autrefois Yoyo. Ils racontent qu'un jour, il y a très longtemps, deux hommes essayèrent de traverser le fleuve qui parcourt la région. L'un deux fut emporté par les flots et se noya. Son compagnon, bouleversé par ce qui venait de se passer, se mit à crier «Yoyo»! pour donner l'alerte. Un des anciens se souvenait avoir entendu parler de cet incident en 1947. Il fut donc décidé de prendre l'année 1947 comme point de départ. En 1948, le gouvernement colonial aménagea une auge à bétail afin de préparer l'endroit pour l'établissement des colons. Cette auge était alimentée par la source de Kandaga (grâce à un système d'approvisionnement par gravité). En 1949, la majorité des gens de Chakwe, un village voisin de la ville de Kondoa, furent déplacés de force à Kwayondu. Les anciens expliquèrent que ce déplacement de population, loin d'être improvisé, avait été prémédité par le gouvernement colonial. En effet, quelque temps auparavant, les autorités coloniales avaient préparé la région pour de nouvelles implantations de populations en recrutant des gens de la région pour défricher la forêt dans le cadre du programme de lutte contre la mouche tsé-tsé et bâtit des huttes de tembe en gourbi et écouvillons dotées de toitures-terrasses. Les habitants de Chakwe furent amenés sur place dans des camions gouvernementaux. Arrivés à Kwayondu, on leur dit: «Voici vos huttes, c'est ici que vous habiterez désormais.» Le nouveau village était infesté de moustiques, à tel point que les gens ne pouvaient même pas dormir dans leurs huttes. Ils furent obligés de dormir sur les toitures-terrasses de leurs tembe. Un des anciens raconta comment, une nuit, alors petit garçon, il tomba du toit pendant son sommeil et se cassa le bras. Puis il montra à tout le monde la cicatrice qu'il avait conservée de cet épisode. Le village fut baptisé Kwayondu en
raison des innombrables ruches d'abeilles installées dans les baobabs. Les ruches
appartenaient à un homme du nom de Yondu. Mzee Yondu habitait à Bukulu, un
village éloigné, proche de la frontière occidentale de la division de Bereko. Lorsqu'il
s'aperçut que le terrain où se trouvaient ses ruches était défriché, il demanda au
gouvernement colonial d'épargner les baobabs. Il se rendit chez le Commissaire de
district, muni d'un échantillon du miel de ses abeilles. Le commissaire accepta
d'épargner les arbres, et c'est ainsi qu'on peut encore les admirer à ce jour... |
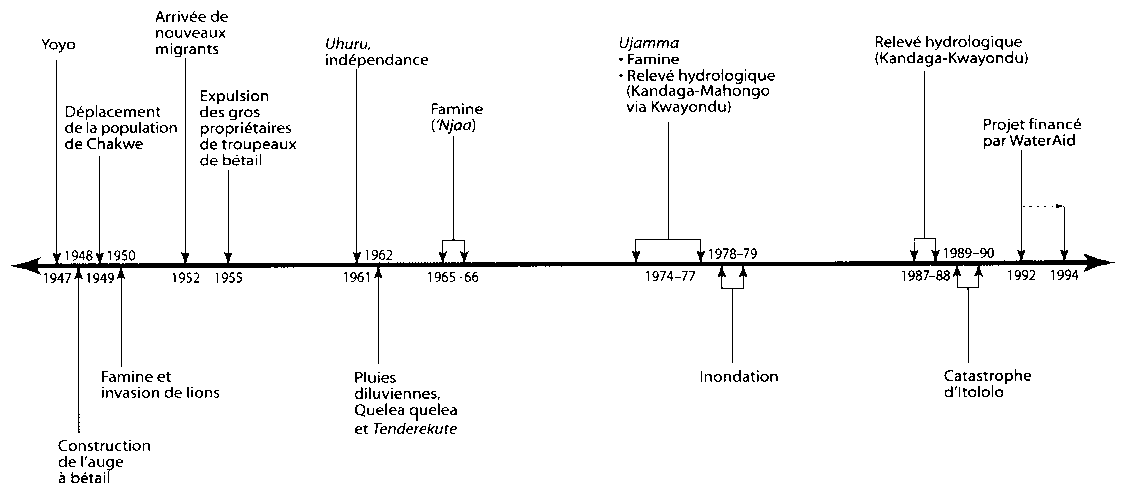
Également empruntée à l'ERP, cette méthode est largement utilisée dans d'autres types de démarches participatives. Il est demandé aux participants de dresser une carte représentant leur territoire, en y indiquant les endroits qui ont de l'importance pour eux (marchés, mosquées, églises, etc.) et ceux qui intéressent les investigateurs (sources d'approvisionnement en eau et installations d'assainissement).
Objet
• Savoir à quelles installations publiques de santé et d'hygiène la communauté a accès (par ex., source d'approvisionnement en eau).
• Se renseigner sur les ressources hygiéniques et sanitaires dans les maisons des gens (latrines, fosse à déchets, égouttoirs à vaisselle, etc.). Il pourrait s'agir d'articles qui ont été introduits ou mis de l'avant par votre projet.
Matériels
Ils dépendront des ressources disponibles. Les cartes pourront être réalisées au moyen de bâtons, que l'on utilisera pour tracer des traits à même le sol, et de cailloux et de feuilles que l'on placera aux endroits importants. Si les participants ont l'habitude d'employer des stylos et du papier et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à les utiliser. Les tableaux-papiers et les marqueurs, ou le tableau noir et la craie sont d'autres possibilités.
Procédure
Les directives suivantes pourront être utiles à l'animateur:
• Présentez-vous et exposez l'objet de la réunion et de l'activité prévue. Exprimez-vous clairement dans la langue locale.
• Expliquez la tâche. Accordez suffisamment de temps aux participants pour discuter du concept de la carte, poser des questions et faire des suggestions sur la façon de dresser la carte et de choisir les matériels. (Parfois, les villageois préfèrent écrire sur du papier avec des crayons ou au tableau avec de la craie).
• Écoutez, regardez et apprenez.
• Encouragez/stimulez la discussion, mais n'imposez pas ce qui doit figurer sur la carte.
• Conservez une liste des participants que vous pourrez consulter plus tard pour vérifier les indications sur la carte en les comparant aux informations obtenues au moyen d'autres outils.
• Lorsque la carte est finie, montrez-la au groupe et demandez aux participants de discuter d'éventuels changements à apporter.
• A un autre moment, présentez la carte devant un groupe plus important de participants. Par exemple, vous pouvez débuter votre prochaine discussion en groupe par un compte rendu de ce que vous avez appris sur l'histoire locale à l'aide de la carte. Ainsi, vous aurez plus de chances de susciter l'intérêt des participants.
Gestion, examen et utilisation des informations
La carte contient des informations sur les caractéristiques physiques de la localité et sur l'attitude des gens à leur égard. Souvent, la réalisation de la carte proprement dite et la recherche de renseignements sur le contexte local à travers les discussions sont aussi importants que les informations figurant sur la carte.
Les cartes fournissent des informations qui sont facilement quantifiables, notamment le nombre de fermes familiales par village ou même le nombre d'installations hygiéniques dans chaque cour (la figure 4 présente une carte de deux villages du Kenya occidental où plusieurs installations améliorant les conditions d'hygiène, que l'on doit au projet SHEWAS, ont été indiquées). Les informations figurant sur cette carte sont présentées sous forme de tableau dans l'encadré 15. Cela a permis à l'équipe chargée de l'étude de prendre des décisions éclairées concernant l'échantillonnage des entrevues semi-dirigées avec les mères de jeunes enfants. Ici, le nombre de foyers dans les deux villages était le même, mais le nombre de familles ou de foyers dans chaque ferme familiale/cour allait de 6 à 10. Toutefois, l'intérêt des cartes réside le plus souvent non pas dans les informations tabulées, mais dans l'analyse qui en est faite lors de la discussion, car elle permet d'interpréter les chiffres et de comprendre leur importance.
ENCADRÉ 15. Exemple d'informations quantifiables obtenues à partir des cartes présentées à la figure 4
Caractéristiques et indicateurs |
Haudinga |
Masanga |
Fermes familiales (groupes de foyers) |
33 |
33 |
Fermes familiales avec de jeunes enfants |
20 |
21 |
Latrines à l'intérieur |
4 |
1 |
Latrines à l'extérieur |
17 |
25 |
Lavabos (pour se laver les |
||
mains en sortant de la latrine) |
2 |
9 |
FIGURE 4. Cartes des villages de Masanga et Haudinga, Kenya (Nombre de participants/informateurs = 21 et 19 respectivement)
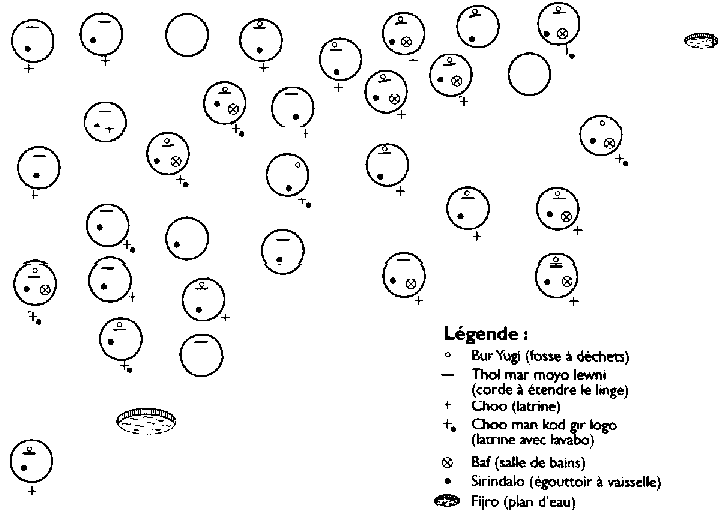
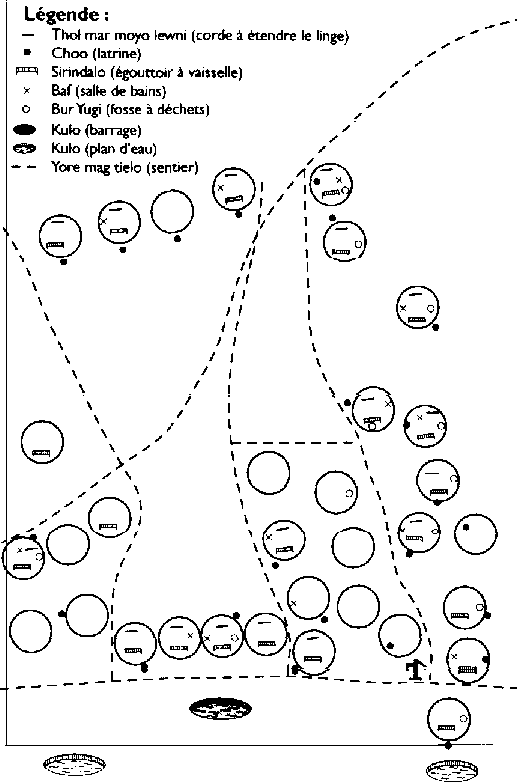
Tiré d'une copie de l'original de Tom Mboya (Projet SHEWAS)
Dans certains cas, les cartes peuvent inclure des détails politiquement sensibles, comme la délimitation des frontières (voir encadré 16).
La carte peut servir d'outil de
surveillance pour de futures évaluations. Comme pour l'historique, la carte pourra servir
de document permettant de conserver une trace de la situation existante au moment de
l'étude. La carte doit être datée pour permettre de noter d'éventuels changements lors
de visites ultérieures dans la région ou d'évaluations des pratiques d'hygiène dans le
cadre du suivi. Par exemple, une carte créée deux ans après celles présentées à la
figure 4 pourrait faire apparaître que plusieurs latrines ont été construites dans la
cour intérieure de la ferme familiale suite à une solution trouvée par les membres de
la communauté pour contourner le tabou culturel interdisant des membres de la
belle-famille de partager les latrines.
Également empruntée à l'ERP, cette méthode sert à présenter des informations variées et en grandes quantités dans une base de temps commune. Cette méthode permet de représenter visuellement les explications de la population locale sur la configuration saisonnière des pluies, du travail agricole (généralement différencié par sexe), des maladies, etc., en utilisant des matériels locaux.
ENCADRÉ 16. Exemple de questions délicates pouvant résulter de la cartographie Du village de Kwayondu, Tanzanie Certains membres de la communauté
ont exprimé leur inquiétude concernant les limites du village telles qu'elles figurent
sur la carte de Kitongoji A (un quartier du village). Ils ont expliqué [aux
membres de l'équipe chargée de l'étude] qu'ils étaient en conflit avec les habitants
d'un village voisin concernant la propriété de certains terrains situés dans la zone
frontalière entre les deux villages. L'affaire a été portée devant les tribunaux mais
n'est toujours pas résolue. La carte présentée par l'équipe chargée de l'étude
semblait favoriser la partie adverse. Après avoir discuté en détail du problème, les
participants ont accepté la carte, mais ont demandé á l'équipe de ne pas la montrer
aux habitants du village voisin, de peur qu'elle ne soit utilisée comme une preuve à
charge contre eux. |
Objet
• Obtenir des informations détaillées sur les activités locales des hommes, des femmes et des enfants à différentes époques de l'année
• Découvrir quelles sont les maladies perçues comme les plus importantes et leur prévalence selon l'époque de l'année
Un système de classement peut être utilisé pour aider les participants à indiquer l'intensité (faible, moyenne ou forte) de telle ou telle activité au cours d'un mois donné. Pareillement, les indicateurs climatiques (pluies et températures) pourront être classés en fonction de leur intensité (faible, moyenne ou forte), tout comme la prévalence des maladies les plus importantes et les plus courantes.
Matériels
Les matériels requis pour cet outil sont les mêmes que ceux décrits plus haut pour la cartographie.
Procédure
• Présentez-vous et exposez l'objet de la réunion et de l'activité prévue.
• Donnez vos instructions clairement en vous exprimant dans la langue locale et accordez suffisamment de temps aux participants pour discuter du calendrier local, poser des questions et choisir les matériels qu'ils souhaitent utiliser. Rappelez aux villageois que vous êtes là pour apprendre, et non pour porter des jugements ou donner votre avis.
• Écoutez (regardez) et apprenez.
• Encouragez tous les participants à donner leur avis et discutez de chaque suggestion.
• Conservez une liste des participants pour savoir qui est qui au moment d'étudier les données.
• Une fois terminé, recopiez le calendrier sur un tableau-papier ou sur un tableau noir, présentez-le aux participants et invitez-les à faire des commentaires et des suggestions. Faites les corrections et les changements qui s'imposent sur place.
• À un autre moment, présentez le calendrier saisonnier devant un groupe plus important de participants à l'étude. Par exemple, vous pouvez débuter votre prochaine discussion en groupe par un compte rendu de ce que vous avez appris sur le climat, les maladies et les activités à l'aide du calendrier saisonnier. Ainsi, vous aurez plus de chances de susciter l'intérêt des participants.
Gestion, examen et utilisation des informations
Vous pouvez stocker les données obtenues sur des graphiques en barres accompagnés d'une interprétation légendée (voir par exemple la figure 5 et l'encadré 17). Ici, le calendrier lunaire traditionnellement utilisé par les Gogo a été aligné sur le calendrier géorgien (européen). Les indicateurs sur l'ordonnée signifient un peu (kidogo), moyennement (wastani/kiasi) et beaucoup (sana) dans la langue Kiswahili. On a demandé aux participants de se concentrer sur les maladies qui ont touché les enfants au cours de l'année écoulée. Les informations fournies comportaient également les maladies des adultes, et on en a déduit que les conditions climatiques et la répartition des maladies étaient plus ou moins identiques d'une année sur l'autre.
Un calendrier saisonnier, noté sur
tableau-papier ou sur un support de papier comme celui présenté à la figure 5, qui se
trouve dans le rapport de l'étude d'évaluation hygiénique de Dodoma, peut servir de
document de référence ou à la surveillance.
L'étude des questions propres au sexe en rapport avec l'affectation des tâches et la gestion des ressources est importante pour comprendre le contexte servant de cadre aux pratiques d'hygiène. L'un des meilleurs moyens d'aborder ce sujet avec les participants est d'utiliser des photos représentant les principales activités observées au niveau local. Les participants seront invités à discuter de ces activités et à trouver un consensus sur l'affectation des tâches effectuées par les hommes, les femmes ou les deux.
Le même principe pourra s'appliquer à une série d'illustrations représentant des ressources produites et utilisées localement, pour lesquelles les participants devront indiquer si elles sont contrôlées par les hommes, les femmes ou les deux.
Objet
• Découvrir quelles activités ou tâches sont acceptables pour les hommes, lesquelles sont affectées aux femmes et lesquelles sont acceptables à la fois pour les hommes et pour les femmes dans la culture locale, et pourquoi.
• Apprendre comment les ressources existantes sont partagées entre hommes et femmes dans la société, quelles ressources sont placées sous le contrôle, ou sont la propriété des hommes, des femmes ou des deux.
Matériels
Munissez-vous d'un jeu de 15 à 25 cartes (illustrations montées sur du papier cartonné) représentant les activités ou tâches importantes les plus courantes sur le site de l'étude, comme la corvée d'eau, la construction de latrines, le nettoyage des latrines, les repas des enfants, la culture de la terre, et ainsi de suite, pour examiner les activités spécifiques à chaque sexe; prévoyez un nombre de cartes identiques sur d'autres ressources comme l'argent, le bétail, les biens du foyer, etc., pour vous renseigner sur le type de ressources que possèdent, ou auxquelles ont accès hommes et femmes. Prévoyez trois cartes représentant un homme adulte, une femme adulte et un couple homme-femme. Les dessins peuvent être réalisés par des artistes locaux ou tirés de brochures illustrées, préparées à l'échelle locale, ou de collections de photos qui pourront être agrandies et photocopiées pour l'occasion. Il est important que les cartes illustrent le cadre et les pratiques de la région. Attribuez à chaque carte un numéro de référence pour faciliter la consignation des commentaires des gens.
ENCADRÉ 17. Extraits de notes des discussions sur un calendrier saisonnier Du village d'Asanje, Tanzanie Dans le village d'Asanje, les calendriers saisonniers des activités, des maladies et du climat ont été préparés au cours de la même séance. Les participants se composaient de 12 femmes et neuf hommes qui ont commencé par les maladies les plus répandues. La première maladie cirée était le degedege qui signifie littéralement "convulsions". Le terme est couramment employé pour désigner la malaria. Le terme de homa, qui signifie fièvre, a également été employé en référence à la malaria. La fièvre et les convulsions ont été associés à la saison des pluies. Les participants ont convenu que le degedege est la maladie la plus fréquente de janvier à avril. Faible en janvier (peu de gens sont touchés, surtout des enfants) son incidence augmente en février (une proportion moyenne de personnes sont touchées), et atteint son pic en mars et avril (la majorité des enfants et une bonne partie des adultes sont atteints). Le soigneur traditionnel a indiqué qu'il avait traité de nombreuses personnes atteintes de degedege au cours des derniers mois. Les femmes ont rappelé que des enfants étaient morts de la maladie ces derniers mois, mais elles n'ont pas signalé de décès parmi les adultes... Les précipitations ont été importantes en janvier, faibles en février, moyennes en mars et avril, et à nouveau faibles en mai... Quand on leur a demandé pourquoi la shamba avait été agrandie après les semences, et pas avant, les participants ont expliqué que c'était pour des raisons de sécurité. Si la shamba est trop proche de la brousse, il est plus difficile pour le fermier de protéger ses cultures contre les invasions d'animaux sauvages, comme les babouins et les sangliers, sans risquer d'être lui-même victime d'attaques de prédateurs, en particulier les hyènes, les guépards ou les léopards. Les hommes ont signalé qu'au moment de l'étude, ils devaient passer des nuits entières à la belle étoile pour protéger les shambas des sangliers. Le mois d'août n'a pas été trop
chaud, contrairement aux mois de septembre et octobre où les températures ont atteint
des sommets. Au cours de ces deux mois, les adultes (en particulier les femmes) se sont
plaints de maux de tête. Mais c'est la seule maladie à avoir touché une majorité des
habitants. Les maux de tête étaient provoqués par les longues marches quotidienne (de
Babayu et Maya Maya) pour aller chercher de l'eau. Les femmes portaient l'eau sur leur
tête alors que les hommes, qui participent habituellement à la corvée d'eau en cette
période de l'année, utilisaient des brouettes et des bicyclettes, du moins ceux qui en
possédaient. Après discussion, les participants ont convenu que de nombreuses personnes
souffrent de diarrhée en novembre et en décembre, au commencement de la saison des
pluies. |
Procédure
Les directives suivantes pourront être utiles à l'animateur:
• Présentez-vous et exposez l'objet de la réunion et de l'activité prévue. Exprimez-vous clairement dans la langue locale.
• Demandez aux participants si les illustrations représentent des scènes familières et si les tâches décrites sont plus souvent accomplies par les hommes, par les femmes, ou les deux, et pourquoi. Concernant la répartition et la gestion des ressources, demandez aux participants si les ressources représentées sont courantes, et à qui leur gestion et leur contrôle sont habituellement confiés aux hommes, aux femmes ou les deux, et pourquoi.
• Si cela est nécessaire (pour permettre aux participants de parler plus librement ou pour avoir des avis différents des différentes catégories de la population), répartissez les participants en petits groupes, par âge, ou par sexe, par exemple.
• Distribuez les cartes et demandez aux participants de les faire circuler en prenant le temps de les regarder attentivement, puis discutez de chaque carte.
• Écoutez et apprenez.
• Demandez au groupe de classer les cartes en trois catégories: bonne, mauvaise ou ni bonne, ni mauvaise, cette dernière catégorie étant réservée aux illustrations trop vagues ou lorsque le groupe ne peut décider à l'unanimité si une pratique est bonne ou mauvaise.
• Prenez des notes sur les débats (y compris la décision finale, le nombre de participants) mais évitez d'intervenir.
Gestion, examen et utilisation des informations
Les procédures suivantes vous aideront à traiter les informations obtenues de façon systématique:
• Rédigez vos notes. Décrivez les participants/échantillons et récapitulez les commentaires de chaque groupe sur les cartes. Dressez une liste des principaux points et questions soulevés au cours de la discussion, ainsi que les points de désaccord et les idées imprévues qui ont été suggérées. Cette foule d'informations donnera une idée des tâches, responsabilités ou propriétés qui, aux yeux des participants, doivent être du domaine exclusif de l'homme, de la femme, ou des deux, sans pour autant constituer une preuve. Elle constituera un point de départ pour des investigations approfondies, faisant intervenir d'autres méthodes, telle l'observation, les entrevues, ou les discussions en groupe des principales questions.
• Dressez la liste des dessins en les classant par numéro et collationnez les commentaires du groupe sur chaque dessin.
• Relisez les commentaires de chaque groupe et faites ressortir les points de vue et les convictions identiques. Définissez des questions spécifiques dans le but de réaliser des investigations plus poussées.
• Préparez des copies réduites de chaque dessin que vous incorporerez dans votre rapport d'étude accompagnés des résumés des commentaires. Ils seront ensuite placés dans une annexe du texte de votre rapport (encadré 18).
ENCADRE 18. Commentaires sur les illustrations de la répartition hommes-femmes des tâches sur la planche 1 D'Afghanistan et d'Éthiopie Illustration 1
Illustration 2
|