ISSUE 41: MARS-MAI 2006
international de centres et programmes de recherche et de formation
Nouveautés des Presses de l’UNU
 |
Réforme du secteur de sécurité et
construction de paix post-conflit
Edité par Albrecht Schnabel et Hans-Georg
Ehrhart
Dans cet ouvrage, un groupe international d’universitaires et de praticiens analyse les expériences des programmes de réforme des secteurs de sécurité dans différentes régions du monde, afin d’offrir une vue d’ensemble de la complexité de réformer les secteurs de sécurité et des relations entre militaires et
civils.
Les forces militaires et policières jouent un rôle déterminant dans la réussite à long terme des efforts politiques, économiques et des efforts de reconstruction culturelle dans les sociétés post-conflit. Cependant, malgré leur tâche qui consiste à assurer un environnement de sécurité propice à reconstruire les sociétés détruites par la guerre, les structures de sécurité interne ont tendance à manquer de contrôle civil et démocratique, de cohésion interne et d’efficacité, ainsi que de crédibilité publique.
Ces structures doivent être placées sous contrôle démocratique, restructurées et réformées pour être actives dans le processus de construction de paix. Des acteurs externes venant d’autres Etats, des organisations régionales et des Nations Unies peuvent être utiles en créant un environnement de sécurité de base, en empêchant le reste des groupes armées de détruire la fragile construction de la paix, notamment en facilitant la réforme du secteur de sécurité local.
- Albert Schnabel est chercheur (hors classe) à la fondation de Swisspeace et professeur à l’Institut des sciences politiques à Berne.
- Hans-Georg Erhart est chercheur (hors classe) et professeur à l’Institut de recherche pour la paix et les règles de sécurité à l’Université de Hambourg.
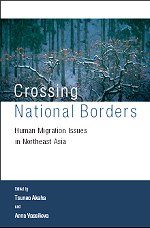 |
Mouvements transfrontaliers: problèmes de
migration humaine dans le Nord-Est de l’Asie
Edité par Tsuneo Akaha et Anna Vassilieva
La migration internationale et les autres types de mouvements humains transfrontaliers sont en train de devenir un facteur important dans les relations internationales dans le Nord-Est de l’Asie. Dans cette étude pionnière, des experts de la Chine, du Japon, de la Corée, de la Mongolie et de la Russie examinent les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles de l’interaction entre les individus transfrontaliers et les communautés qui les accueillent, soulignant les problèmes auxquels font face les dirigeants nationaux et locaux dans chaque pays et suggérant les changements nécessaires au niveau des règles nationales et internationales.
Les auteurs analysent les tendances de population et les structures de migration dans chaque pays : l’immigration chinoise dans l’Extrême-Orient russe ; les Chinois, Coréens et Russes au Japon ; les Coréens du Nord en Chine, et les problèmes de migration en Corée du Sud et en Mongolie. Le livre introduit de nombreuses données empiriques et aborde à la fois les études de migration internationale et les études régionales du Nord-Est de l’Asie.
- Tsuneo Akaha est professeur des études de sciences politiques internationales et directeur du Centre des études de l’Asie de l’Est, Institut de Monterey des études internationales, Californie, Etats-Unis.
- Anna Vassilieva est professeur adjoint et Directrice du programme des études russes, Institut de Monterey des études internationales, Californie, Etats-Unis.
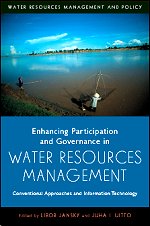 |
Edité par Libor Jansky et Juha I. Uitto
Le but de cet ouvrage est d’approfondir la connaissance des approches et des techniques de participation publique afin d’améliorer la gestion des ressources en eau. Le livre tire son origine du symposium sur « La participation publique et la gouvernance de gestion des ressources en eau », qui s’est tenu à Tokyo au Japon.
Les Nations Unies estiment que plus de 2 milliards de personnes dans plus de 40 pays sont affectés par les pénuries d’eau. La demande croissante d’eau a été identifiée comme l’un des quatre facteurs les plus menaçants pour la santé humaine et écologique de la prochaine génération.
La gestion de l’eau peut se définir comme l’ensemble des règles et activités qui sert à fournir de l’eau propre pour subvenir aux besoins humains dans différents secteurs et pour entretenir les systèmes écologiques liés à l’eau desquels nous dépendons.
L’Association internationale pour la participation publique décrit la participation publique comme « tous les processus qui incluent le public dans la résolution de problèmes ou dans la prise de décision ». La participation publique vise à augmenter l’attention envers les intérêts des personnes qui sont normalement marginalisées et leur inclusion ; par exemple celles des minorités politiquement privées de droit électoral ou des pauvres, qui sont indirectement affectés par la gestion de l’eau.
Dans cet ouvrage, les auteurs identifient les mécanismes qui fonctionnent, les approches et les outils pour promouvoir l’engagement public dans la gestion d’eau, en incluant les approches conventionnelles et celles basées sur les technologies de l’information.
- Libor Jansky est administrateur des programmes académiques (hors classe) pour le Programme environnement et développement durable de l’Université des Nations Unies, Tokyo, Japon.
- Juha I. Uitto est coordinateur de surveillance et d’évaluation (hors classe) aux Fonds pour l’environnement mondial, Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD), New York, Etats-Unis.
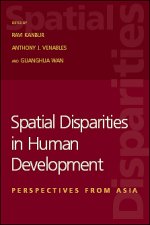 |
Disparités spatiales dans le développement humain: perspectives de l’Asie
Edité par Ravi Kanbur, Anthony J. Venables et Guanghua Wan
L’inégalité spatiale est une dimension d’inégalité générale, mais a encore plus d’importance lorsque les divisions spatiales et régionales correspondent aux tensions politiques et ethniques et mettent en cause la stabilité politique et sociale. Cet ouvrage contient une sélection de documents présentés à la conférence de UNU-WIDER sur les disparités sociales en Asie, qui s’est tenue au mois de mars 2003 au siège de l’UNU à Tokyo. Il met l’accent sur la pauvreté et l’inégalité, qui sont directement liées aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Plus spécifiquement, c’est une étude transversale de différents pays, qui traite un nombre de pays et de régions qui attirent l’attention professionnelle et politique comme la Chine, la Russie et les pays de l’Asie Centrale. Le livre aborde de nombreux sujets dont notamment les liens entre conflit et inégalité, l’étude de la pauvreté ainsi que les causes et les conséquences de l’inégalité. Au cours de cette étude sont appliquées les dernières techniques de recherche comme la décomposition à base de régression, la décomposition de pauvreté et des modèles informatiques d’équilibre général.
Grâce aux contributions théoriques et empiriques venant de quelques-uns des économistes les plus importants dans le domaine des études d’inégalité et de développement, cet ouvrage suscitera l’intérêt des économistes, des sociologues et des décideurs en Asie et ailleurs.
- Ravi Kanbur est professeur titulaire de la chaire T.H. Lee des Affaires mondiales et professeur d’économie politique à l’Université de Cornell, New York.
- Anthony J. Venables est professeur d’économie politique internationale à la London School of Economics (LSE), directeur du programme de globalisation au centre de performance économique et chercheur au Centre de recherche d’économie politique de LSE, Londres.
- Guanghua Wan est chercheur (hors classe) et directeur de projet à UNU-WIDER, Helsinki.
© 2006 Université des Nations Unies